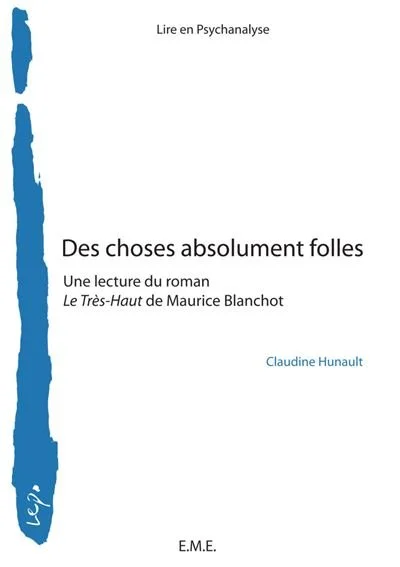DES CHOSES ABSOLUMENT FOLLES
Une lecture du roman Le Très-Haut de Maurice Blanchot
Éditions E.M.E. & InterCommunications, sprl, 2012
Le Très-Haut est une des plus étranges fictions que Maurice Blanchot ait écrites. Le Très-Haut pourrait, dans ses premières pages, donner l’impression d’un roman réaliste : Henri Sorge est dans le métro, il reçoit un coup de poing, la police arrive. Et là, l’histoire bifurque. Sorge refuse de porter plainte et questionne son agresseur sous les regards courroucés des agents et des badauds qui tous attendaient la suite logique de l’événement. Nous voyons alors s’emboîter les pièces d’un univers qui se construit à partir des perceptions de Sorge et qui se déploie en dehors des lois qui proscrivent la contradiction. Chaque situation se donne dans une multiplicité simultanée des sens. Les objets perdent leur inertie et entrent avec Sorge dans une relation menaçante et imprévisible. Les objets voient Sorge. Ils sont dotés d’une existence autonome et il n’y a plus de limite à ce qui arrive : la robe d’une femme prend corps, une tache noire se déplace et se déforme de scène en scène, Sorge souffre du mur plus que de l’abcès qu’il a sur la jambe. L’espace est lui aussi autonome, doué d’intentions. Sorge est vu par l’espace et sollicité par lui. Dans quelle réalité tout cela arrive-t-il ?
Claudine Hunault met en scène une lecture du Très-Haut articulée selon la loi du fantasme. Elle entraine le lecteur dans les péripéties d’un sujet, Sorge - autant dire chacun de nous dans son souci de vérité – qui, malgré son acharnement à bien faire, à bien travailler, à bien aimer, malgré sa servitude aussi remarquable que volontaire à l’égard de l’Etat, perd inexorablement son identification. C’est affaire de sensibilité et Claudine Hunault conduit le lecteur jusqu’au point brûlant des perceptions dévastées de Sorge. Elle dessine, dans sa lecture, la ligne de faille qui traverse Le Très-Haut de part en part jusqu’à l’événement final : le surgissement d’une parole inédite, « — Maintenant, c’est maintenant que je parle ».
Critique de Jean-Louis Chassing
Psychanalyste, psychanalyste membre de l’A.L.I. Association Lacanienne Internationale.
La collection « Lire en psychanalyse », dirigée par Christian Fierens et Guy Mertens, définit joliment le fait de lire, ici, en psychanalyse, comme celui d’ « entrer dans la mouvance de la lettre », « la prendre et la faire travailler comme signifiant… ». « Lire en psychanalyse, disent les auteurs-directeurs, consiste à ouvrir l’avenir des textes fondateurs en leur donnant la puissance de signifiant, c’est-à-dire de signifier au-delà de ce qu’ils signifient grâce à l’acte de lecture ».
Un des premiers ouvrages de la collection, illustrant cette « ouverture », est une lecture d’un roman de Maurice Blanchot. « Le Très-Haut », paru en 1948, est le dernier roman de Blanchot, qui écrira des récits par la suite. « Le récit, écrit Blanchot, comme le rappelle Claudine Hunault dans son beau livre, n’est pas la relation de l‘événement, mais cet événement même ». Ce que l’on peut lire comme une tentative d’écriture du réel, tout du moins, écrit toujours Claudine Hunault, « Il s’agit d’un travail poétique de l’imaginaire, d’un savoir faire pour se rendre au bord, et toucher à des fragments de réel ». Et c’est la thèse de Claudine Hunault, et, nous le verrons, pas seulement d’elle ! Cette écriture, dit-elle, celle de Blanchot, ici même dans ce roman, est une approche du fantasme ; du fantasme au sens développé par Lacan – la collection du livre est une collection de psychanalyse, en son rapport à la lecture. « Ce qui advient, advient en premier lieu dans l’écriture et notre corps en est affecté » écrit Claudine Hunault. Fin de roman, passage au récit.
Dans le séminaire « Le désir et son interprétation », Lacan dit que « … l’analyse n’est pas un επος (epos), l’analyse n’est pas un εθος (ethos). Si je la comparais à quelque chose, c’est à un récit qui serait tel que le récit lui-même soit le lieu de la rencontre dont il s’agit dans le récit » (leçon du 1er juillet 1959 ; éd. de l’Association freudienne internationale). Le désir c’est le désir de l’Autre et ceci s’applique comme règle dans l’analyse. L’analyse n’est pas une historiette racontée « pour » son contenu historique, mais pour prendre celui-ci à la lettre, afin d’en laisser émerger le désir. Si le désir survient en filigrane dès le début du livre de Claudine Hunault, c’est à la fin que l’auteure délivre, dénoue habilement et de manière parfois franche, osée dans ses interprétations, les rapports du désir et de la jouissance dans l’écriture du roman de Blanchot.
Les diverses critiques des écrits de Maurice Blanchot mentionnent souvent le fait que Blanchot est avant tout lecteur. Lecteur des autres, lecteur de lui-même… Le passage de la lettre, du regard au corps, s’effectue-t-il lors du geste, lors de l’écrit du corps dans une anticipation à peine esquissée de la pensée, elle-même liée malgré elle aux déplacements inconscients ? La lettre, objet particulier, face réelle du signifiant. Mais aussi, comment Blanchot lisait-il… s’imprégnait-il ? Quelle était l’architecture de son « acte de lecture », pour reprendre l’expression, citée plus haut, des directeurs de la collection « Lire en psychanalyse » ? La phrase suivante de Claudine Hunault est complexe, et explicite de son hypothèse : « La manière dont l’écriture de Blanchot se creuse, se sculpte de la vision qu’elle soutient du fantasme… ». Le fantasme ne s’écrit pas mais il soutient… Si selon Lacan le désir se soutient du fantasme, ici le désir serait « écrasé » par l’écriture, « trouverait » en ses lieu et place l’écriture ; comme si celle-ci venait crument, violemment, ici donner « à voir » le fantasme… « … l’écriture de Blanchot… se sculpte de la vision qu’elle soutient du fantasme… ». Ce qui n’abolit évidemment pas la place du désir si ce n’est qu’il serait en quelque sorte, ne serait-ce que momentanément, recouvert par une écriture, et qu’il viendrait à surgir en sa violence à travers l’écriture. Dans le livre de Claudine Hunault les relations entre fantasme, désir et écriture sont à lire « à la page » et aussi à rebours, à relire.
Ceci n’est pas sans rappeler ce que Lacan dit à propos de l’homme aux loups, lorsqu’il parle justement du fantasme et du fameux rêve « encadré » de l’homme aux loups. Et notamment lorsqu’il décrit ce dernier comme « état-limite », ce cas border-line, et lorsqu’il tente brièvement d’en distinguer la structure d’avec celle d’une schizophrène. Il est question du cadre, cadre de la fenêtre avec au delà les loups sur les branches de l’arbre, figures phalliques selon Lacan, alors que pour la schizophrène au bout des branches ce sont les lettres, qui désignent, des lettres qui donnent l’être – « je suis lettre » - le fantasme n’apparaît plus alors, fut-ce dans l’angoisse, comme ce qu’il est, cadre venant poinçonner un rapport à l’objet, mais comme « évanouit » dans une plus grande proximité encore avec le réel de l’objet. C’est-à-dire laissant effleurer la place de la Chose, Das Ding telle que Lacan la dessine dans le séminaire sur « l’Ethique ».
Il y a ce serrage de l’objet, sur, avec, et par l’écriture, et un mouvement d’échappement. Ceci n’est pas sans en rapprocher ce qui est repéré par Claudine Hunault comme une « obsession de faire sens ou de ce que la vie fasse sens » dans « la poétique de Blanchot ». Elle compare cela, à un moment de son analyse, avec le Beckett du livre « Le Dépeupleur ». Une obsession qui tourne en vain, si ce n’est à rechercher, à fouiller son vide. « L’écriture du Très-Haut s’adresse à l’être même de la parole et le représente dans son inaccessibilité… » écrit-elle. Ou encore « Equivoque, Le Très-Haut se serre de façon impitoyable sur son énigme, l’épidémie, et en même temps il fait eau de toute part. » Ce mouvement d’aller et venue, d’approche et d’échappement, d’intensité et de vide ou plutôt du « rien », est perceptible en « sous-jacence » de l’écriture de Claudine Hunault, prise par son objet-lecture. Lecture en psychanalyse. « Je parle ici de Sorge et je parle de Blanchot, sans instaurer pour autant un quelconque rapport biographique entre eux ». « Étrangement, l’indifférence ne va pas sans entêtement… ».
Nous trouvons ce type de formulation également, au cours d’une autre comparaison, « (Blanchot et…) Giacometti semblent si proches, à distance l’un de l’autre… ».
Il y a ici une imprégnation, un passage de l’un à l’autre, du mouvement (fantasmatique ?) avec son approche de réel, de Blanchot lecteur à Hunault lectrice de Blanchot écrivain, à Hunault écrivaine. Et pour nous lecteur qu’en est-il, de Hunault, et de Blanchot en nos lectures, et écrit ? Désir ? Désir de lire ? Désir d’écrire ? Mouvance de la lettre mais aussi ici cette prise au corps souvent évoquée par l’écrivaine-lectrice. La force du trait de Giacometti, la puissance de l’écriture de Blanchot. Mais les mots qui traversent l’écriture de Claire Hunault sont encore plus précis, plus forts : « … les coups de crayons laissés par le peintre et qu’il suffirait d’écarter légèrement pour approcher le réel d’une présence qui ne cesse de fuir la prise et dont pourtant le peintre témoigne à travers la force qu’il puise à capter »… « …l’épaisseur des écrits de Blanchot. »
Claudine Hunault est metteur en scène de théâtre et d’opéra, actrice et écrivain. Et manifestement chercheuse, aussi chercheuse de (ce) qui cherche. Présence et absence, et pas seulement présence sur fond d’absence justement, mais présence autrement. Autrement ? Le corps et la lettre s’y prêtent, où se nouent fort l’imaginaire et le réel.
Coup de poing dans le métro….. Début du livre de Blanchot. Agression. « Réponse » déjà curieuse impromptue et dévoilant à la fois l’étrangeté, l’écart, l’évolution du personnage et de la trame textuelle du roman.
Coup de feu à la fin du livre.
Épidémie, insurrection, corps décomposés, cadavres. Crise du Grand Mal, du Haut Mal, du Mal sacré. Épilepsie. Maladie (métaphorique tel que l’écrit Claudine Hunault à la fin de son analyse ?). Violence du récit, du roman en récit en devenir… 1947. Au sortir de la guerre. « Conversion » de Blanchot. Violences.
« J’étais un homme quelconque ». Sorge. Souci.
Imprégnation et passage se retrouvent lorsque l’auteure décrit cette porosité pour le moins – quel nom lui donner pour un clinicien ? – de la frontière entre extérieur et intérieur pour l’homme Sorge, quelconque homme du souci. Bande de Moebius en lecture et écriture…
Le travail, car c’en est un, de Claudine Hunault est remarquable. Laborieux certes en sa lecture, forcé, amusé, respectueux, précis, analytique, nécessaire, intéressant, « blanchotien », interprétatif, avancé, courageux. Elle ne lit pas que Le Très-Haut, mais d’autres écrits de Blanchot : « L’Arrêt de mort », « La Folie du jour », « Thomas l’obscur », « Le Pas au-delà », « L’Écriture du Désastre » ; elle cite : « De Kafka à Kafka », « La part du feu ». Elle cite aussi les autres, autres références qui invitent à lire et à regarder, nombreux, dont bien sûr Levinas, Giacometti, Barthes ou Camus, et Lacan. Nous précisons aussi la qualité de cette édition, les références sont notées, en bas de page.
Le titre du livre – « Des choses absolument folles » - se déploie sous divers aspects. La perception y est souvent en jeu. A propos d’Artaud elle évoque « l’écriture d’une perception folle », puis, liant Sorge et Blanchot elle ajoute « (ce) serait pour Blanchot une façon de forer et forcer la langue, la sienne, à dire ce à quoi elle résiste, ce qu’elle ignore (…) de lui faire rendre gorge, et de vomir l’insu et l’insupportable du fantasme ». Mais c’est plutôt de « ce qui s’élabore en elle » dont il s’agit là, « mon projet d’une certaine manière est une chose absolument folle ». Les « choses folles », ces textes en sont remplis. De la mort aussi. Des pourritures également. Mais c’est dans le jeu de la lettre, dans ce qu’elle touche au corps que l’intérêt extraordinaire réside aussi. C’t’écriture imprègne. Désir et fantasme y sont en monstration. « tel qu’il la regarde, son regard à elle l’absente, et dans cette absence de Sorge, elle perçoit le pouvoir de les entrainer là aussi « à des choses absolument folles » ».
Claudine Hunault cite à la fin « La Logique du fantasme », séminaire de 1967 de Lacan. « Le fantasme est dit dans la mise en scène du ça, « à proprement parler de ce qui dans le discours, en tant que structure logique, est très exactement tout ce qui n’est pas « je », c’est à dire tout le reste de la structure » ». Cette question du fantasme, dont l’auteure donne son hypothèse dès le début à la lecture de Blanchot, envahit les deux livres, celui de Blanchot et celui d’Hunault. Claudine Hunault en tire une analyse, ne cesse d’en tirer analyse. « Est-ce que le fantasme serait le terreau d’une parole qui nous permettrait d’échapper à la prise totalisante dans le langage ? ».
C’est dans le séminaire « L’identification », dans la leçon du 27 juin 1962, que Lacan parle de Maurice Blanchot. Il est très élogieux et en fait « celui qu’il considère (…) comme le chantre de nos Lettres ». Ceci survient après qu’il a parlé du rapport du petit a à la Chose, à Das Ding. Qu’en dit-il au sujet de Blanchot ? Il parle de « L’Arrêt de mort ». « … L’Arrêt de mort était pour moi la sûre confirmation de ce que j’ai dit toute l’année, au séminaire sur l’Éthique, concernant la seconde mort. » Et juste avant : « quelqu’un qui a été incontestablement plus loin que quiconque, présent ou passé, dans la voie de la réalisation du fantasme… ». Cette question de l’objet, de l’horreur, de la peste et du rat, de l’infection, est ainsi présentifiée chez Blanchot. Lacan cite Bataille et Proust.
Blanchot est-il mort ?
Dans l’éloge funèbre qu’il prononça lors de son incinération le lundi 24 février de l’an 2003, Jacques Derrida, l’ami, rappelle la présence incessante de la mort chez Blanchot, dans ses textes et dans sa pensée, et en cet instant solennel énonce cette phrase énigmatique : « la mort de Blanchot est indéniablement survenue, mais elle n’est pas arrivée, elle n’arrive pas. Elle n’arrivera pas ». Enigmatique et à peine explicitée par cette autre phrase clef « La mort toujours imminente, la mort impossible et la mort dépassée, voilà trois certitudes apparemment incompatibles mais dont l’implacable vérité nous fait don de la première provocation à penser. »
Blanchot est-il mort ? Aussi parce que, et Derrida dans cet instant le rappelle également, lire Blanchot n’aura fait que commencer…, les engagements multiples et diversifiés du personnage n’y sont sans doute pas pour rien, mais aussi Blanchot n’a eu ni « influence » ni « disciples ». Il n’a pas fait « école », bien que soit parfois évoquée sa place, entre beaucoup d’autres penseurs, dans ce que les nord-américains ont pu appeler la French theory …
Le livre de Claudine Hunault , qui lance excellemment la collection « Lire en psychanalyse », ce livre n’est pas sans laisser de trace. Il n’est pas celui d’une clinicienne au sens traditionnel du terme, sans pour autant ne pas être celui d’une clinique, psychanalytique. Et c’est aussi son remarquable intérêt. On en sort marqué, abasourdi parfois.
Ainsi que l’écrit Christian Fierens dans sa préface, avant celle de Christophe Bident grand connaisseur de Blanchot : « Il faut suivre cette désidentification propre au symptôme, non pas pour remettre les choses en place, mais pour les déplacer. » Cette première lecture de la collection « Lire en psychanalyse » est prometteuse.
Critique de Marie Jejcic
Docteur en sémiologie littéraire, en psychopathologie et psychanalyse, maître de conférences à Paris XIII.
Extraits.
Une nouvelle collection de psychanalyse est née ; elle s’intitule : Lire en psychanalyse. Le titre est sobre, sa présentation aussi, presqu’un cahier. Un trait de pinceau bleu roi traverse près de la tranche, une couverture blanche glacée. Le trait s’affirme, s’interrompt, reprend. Saisie de l’instant, respiration, simplicité.
La psychanalyse ne manque ni de revues ni de publications. Que peut donc apporter une nième collection dans ce champ ? J’oserai pourtant dire qu’elle manquait à la psychanalyse et, plus largement à l’édition. Je vais tenter de dire pourquoi ?
Aujourd’hui, cette collection propose quatre titres : une lecture du Très-Haut de Maurice Blanchot intitulée Des choses absolument folles par Claudine Hunault, metteur en scène de théâtre et d’opéra. Le livre des poupées qui parlent par Jacques Nassif, La parole et la topologie acte d’une journée d’étude avec ses discussions, enfin un séminaire de Christian Fierens sur Un discours qui ne serait pas du semblant.
J’ai commencé à lire ce livre sur Blanchot. J’ouvre et je lis : « Maintenant, c’est maintenant que je parle. » C’est le titre de l’introduction de Christian Fierens et le mot conclusif du texte de Blanchot. La parole comme urgence d’écrire : cela m’a saisie. Or, cette urgence s’est avérée le point commun des différents titres, chacun préservant le vif de la parole selon une opération que le thème lui impose.
Je lisais et, progressivement, je me sentais décollée du propos où la plupart des recherches actuelles s’épuisent à se maintenir. Se rend-on compte de la façon dont nos livres, leurs écritures, leur démarche ont changé. Se rend-on compte des conséquences de notre docilité consentante à cette nouvelle forme de pensée ? De la vulgarisation d’un savoir qui se croit l’obligé de ses lecteurs et se contraint à rendre tout accessible à tous et un savoir universitaire réduit à une compilation de tout même sur rien ou pour si peu, résultent une amyotrophie de la réflexion flasque à force de ressasser des concepts malmenés par l’usure. Le thème change, la démarche reste la même. Elle procède par accumulation et aboutit aux mêmes conclusions ou presque : un maigre clapotis de vignettes dites cliniques et d’idées élimées. Le savoir made in google est aussi envahissant, clinquant et inutilisable que les objets made in China.
Les auteurs de Lire en psychanalyse ont en commun ce désir d’écrire allégé de tout le fatras d’un savoir mort. Et la lecture s’anime par une réflexion en mouvement. Le désir à la lettre.
La lecture se surprend, retrouve vie. Légère. Non pas que le livre soit inconsistant, tout au contraire. La clarté résulte d’un positionnement où le sérieux de la rigueur trouve la précision. Ainsi, cette lecture du Très-Haut. Claudine Hunault rappelle que le livre ne s’adresse pas à un lecteur, n’a pas à le chercher. « La création poétique dit Blanchot n’est pure que dans l’équivoque ». Blanchot ne s’adresse pas à son lecteur mais au vide du tombeau. […] Et Claudine Hunault en déduit : « Le vide est une réalité que nous éprouvons dans la lecture, nous en faisons l’expérience physique. »
Lire ce vide avant d’écrire et sans se laisser hypnotiser par lui, change l’écriture dont j’éprouve l’opération, car sans doute est-ce cela qui, paradoxalement, allège ma lecture. Apaisement d’un réel humain. Epuisement de la puissance d’un surhomme technologique.